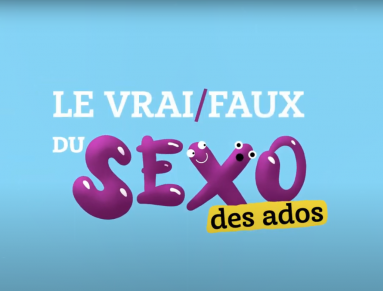Le consentement des enfants a longtemps été un impensé de notre société. Mais la levée progressive des tabous sur les violences sexuelles, ainsi que le mouvement #metoo, a permis d’inviter la sensibilisation au consentement dans les conversations dès le plus jeune âge. « Dans ma famille, se souvient Géraldine, maman d’un petit Gaston, certains adultes avaient une telle autorité que nous devions nous soumettre à chacun de leurs désirs. C’était le cas de mon grand-père, un homme taiseux et tyrannique. Quand nous lui rendions visite pour lui souhaiter la bonne année, il exigeait que chacun de ses petits-enfants l’embrasse dans le cou tandis qu’il nous caressait les fesses, avant de nous donner nos étrennes. C’était un rituel qui nous répugnait tous, mais contre lequel personne, pas même les adultes présents, ne trouvait rien à redire. Alors, depuis que mon fils est tout petit, je lui apprends qu’il a le droit de dire NON. »
Le consentement dès le plus jeune âge
Léa de Macédo, pédopsychiatre au CHU de Nantes, rappelle la nécessité de parler du consentement dès le plus jeune âge, « notamment en ce qui concerne les questions de franchissement sexuel ». Elle recommande d’aborder le sujet spontanément et naturellement. « Car si on est gêné, précise-t-elle, l’enfant risque de penser que c’est un sujet tabou, dont on ne peut pas parler. » Les conversations sur le consentement lié au corps doivent permettre aux enfants d’assimiler le fait qu’un acte interdit doit être dénoncé auprès d’un adulte référent, y compris si l’auteur des agissements est un proche ou un membre de la famille.
L’importance de créer un cadre sécurisant
Pour aider les parents, Léa de Macédo propose d’utiliser des supports graphiques à partir de 2 ou 3 ans, comme les vignettes sur le consentement de l’autrice et illustratrice québécoise Elise Gravel. Certains livres jeunesse à vocation pédagogique sont également de bons outils pour parler du consentement et des violences. On peut citer Petit doux n’a pas peur de Marie Wabbes (La Martinière Jeunesse), destiné aux petits de 0 à 6 ans. « Se baser sur l’utilisation d’un média permet à l’adulte de trianguler, ajoute la pédopsychiatre, ce qui peut être plus confortable pour les parents. » Elle souligne aussi l’importance de sensibiliser les enfants au consentement de l’autre. « On peut, par exemple, les prendre eux-mêmes comme exemple, leur dire : “Tu n’aimerais pas qu’on te fasse telle chose, donc ne la fais pas à tes camarades.” », propose-t-elle. Elle pointe, par ailleurs, une autre difficulté pour les familles : si le consentement de l’enfant est essentiel pour l’aider à se protéger contre un certain nombre d’atteintes, il est cependant indispensable de ne pas le lui demander dans bien des cas de figure. Or, il y a parfois une confusion chez certains parents perdus au milieu des injonctions contradictoires. « Demander son consentement à un enfant petit pour qu’il aille au lit ou qu’il mette son manteau risque de le démunir, explique le médecin. Son cerveau n’est pas encore capable de prendre une décision éclairée. » C’est pourquoi la pédopsychiatre du CHU de Nantes insiste sur l’importance de poser un cadre : « C’est rassurant pour l’enfant et ça lui permet de comprendre qu’il y a aussi des limites à poser à l’autre, ce qui est une base pour aborder la question du consentement. »
Parler du consentement avec les ados
Comme pour la plupart des sujets fondamentaux, il ne suffit pas d’aborder le consentement une seule fois. Le sujet doit revenir ponctuellement dans les discussions, y compris avec les adolescents et les jeunes adultes. Pour échanger avec ces derniers, rarement à l’aise avec ces thématiques, le docteur de Macédo suggère de s’appuyer sur une vidéo populaire sur YouTube, intitulée Tea consent, qui décortique les mécanismes du consentement via une métaphore autour d’une tasse de thé. « Ça donne plein de situations ridicules et ça permet de parler du consentement avec un support hors cadre », explique la professionnelle. Si elle met en garde contre la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, elle conseille, cependant, certains comptes Instagram, notamment Le droit de comprendre le droit, qui accorde plusieurs posts au consentement, et les podcasts féministes qui informent sur le rapport au corps. Elle propose également de recourir à des outils tels que le violentomètre et le « respectomètre », facilement accessibles en ligne, et qui aident à trouver des repères en matière de consentement lorsque le contexte n’est pas évident.