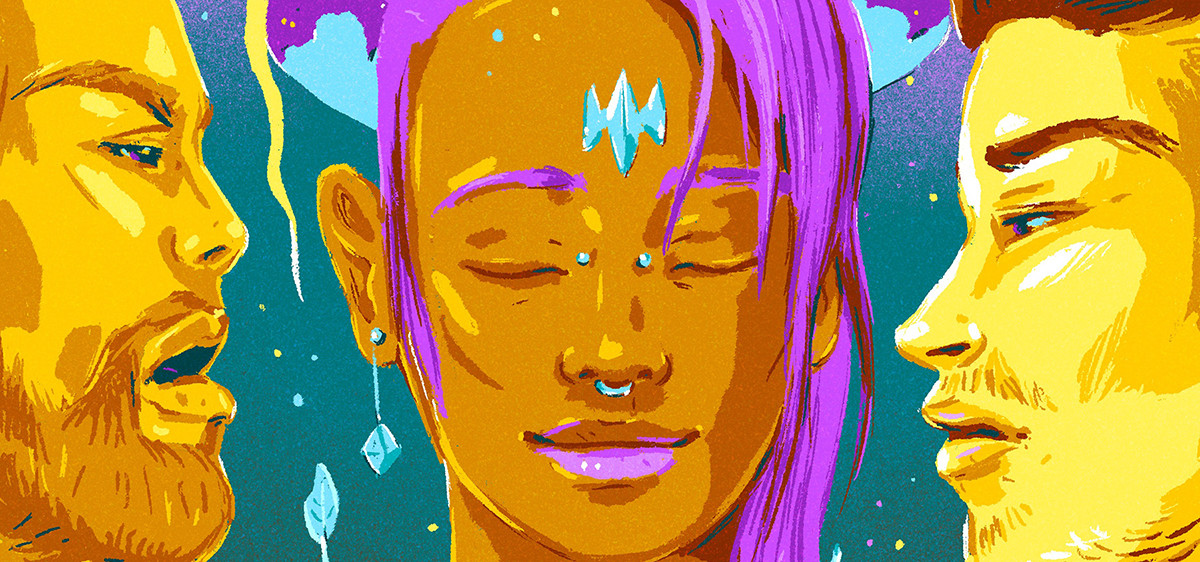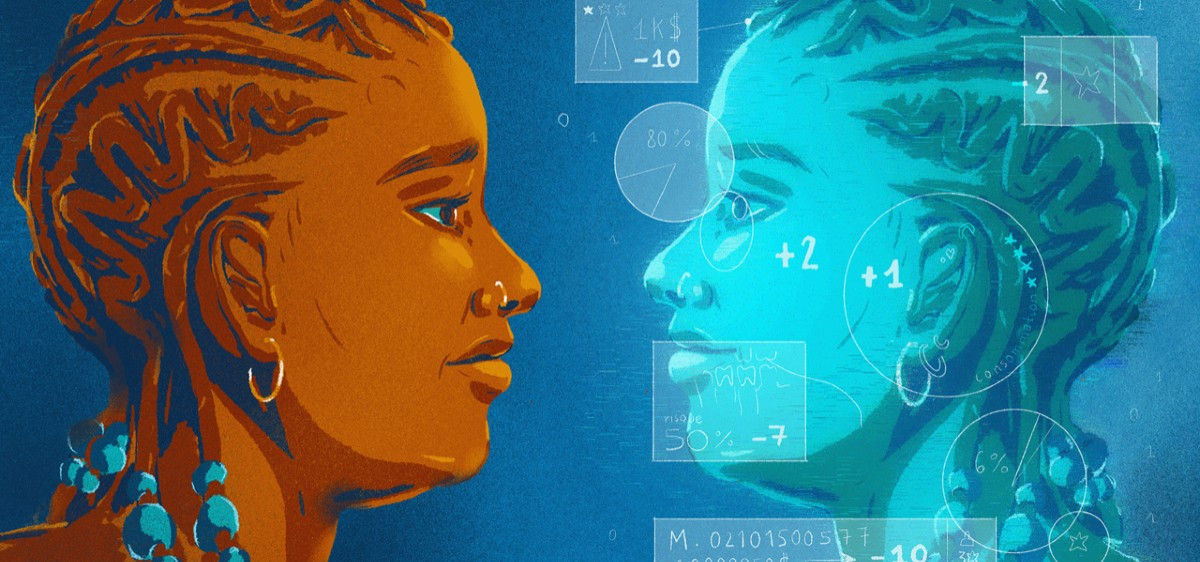Le questionnement des genres et des identités en ligne est central dans chacune de vos deux œuvres. Comment expliquez-vous l’intérêt de ces sujets à l’ère numérique, et l’engagement de chacun.e de vous ?
Ketty Steward : C’est effectivement tout le sujet de mon essai [Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction, paru en 2023 aux éditions L'Inframonde, ndlr] qui porte sur la science-fiction mais dont je sais très bien qu'il peut porter sur plein d'autres thèmes. La science-fiction n’échappe pas au monde blanc, patriarcal, hétéronormé et valide. L'écriture et la mise en récit nous aident à comprendre le monde. Je regrette que la compréhension du monde soit laissée à une poignée de personnes qui ont exactement le même profil, qui apportent des explications fort intéressantes mais qui ne concernent que ce qui les touche. Ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de clarifier mon vécu de 20 ans de fréquentation d'un milieu très blanc, très masculin, avec des idées qui se renouvellent peu. Avec ce constat de manque de pluralité du milieu et des conséquences que ça peut avoir, il s’agit d’avoir la possibilité de regarder les choses sous un angle légèrement différent et théorique. Il ne suffit pas de dire que le milieu de la science-fiction est masculin et fermé, mais que c’est un boys club. Il faut savoir comment ce boys club fonctionne et comment le démanteler. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse : raconter ce qui est pour essayer de trouver comment le défaire, comment faire mieux, comment penser autrement, comment se renouveler. Et si dans la science-fiction on ne peut pas avoir d'imagination, je ne sais pas où on peut en avoir. Les milieux de la science-fiction et du numérique sont quand même très liés historiquement par la construction de ce genre littéraire et ce sont les mêmes constats : comment fait-on pour voir autre chose ? Qu'est ce qu'on fait avec cette pluralité qui existe ? Les femmes existent, les noirs existent, les femmes noires existent, les personnes handicapées existent, les personnes queer existent. Ce n'est plus possible de faire comme si on n'était pas là. On est dans une période un peu tendue, mais on a toujours été là, seulement on en parle un peu plus fort.
Benjamin Fogel : Il est difficile de répondre à cette question sans dévoiler l’intrigue, mais disons que Camille et Irina dans La Transparence selon Irina incarnent quelque chose de féministe derrière leurs écrans, et leur identité est plus complexe que cela. De la même manière, les personnages principaux masculins du Silence selon Manon ne sont pas forcément tout le temps des alliés non plus. Je voulais moi-même me mettre en scène en tant qu'auteur homme et montrer toutes les ambiguïtés sous-jacentes à la fois aux profils anonymes et aux profils publics “transparents”, aux discours. Il s'est passé plein de trucs super grâce à Internet et les réseaux sociaux, du Printemps arabe à #MeToo, des voix y ont trouvé une caisse de résonance hyper forte. Les nouvelles vagues du féminisme se sont beaucoup structurées grâce aux réseaux sociaux et ont réussi à constituer une vraie force agissante sur la société. Et maintenant, il y a un retour de bâton que je trouve ultra violent. Les groupes masculinistes, misogynes, les incels [mot-valise pour « involuntary celibate » soit célibataire involontaire, communauté en ligne d’hommes qui se définissent comme étant injustement empêchés de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle, ndlr].se sont eux-mêmes constitués en force pour les faire taire. Cela illustre beaucoup la question des rapports de force sur Internet. Le combat féministe est loin d'être gagné. Je trouve que ça demande encore énormément d'abnégation et de patience de réexpliquer et prouver les fondements du raisonnement féministe. Je suis très admiratif de ces femmes et de leur combat.
Comment l’imaginaire permet-il de revisiter et de changer le réel ? Comment vos univers y participent-ils ?
KS : Je conçois des ateliers d'écriture, et je trouve que le type de réflexion qu'on a en science-fiction, quand on fait du world building, c’est-à-dire quand on construit un monde, quand on fait de l'imagination sur le futur, c'est quelque chose qui peut aider à penser différemment. Quand je dis qu’on oublie que le numérique a un réel impact écologique qui détruit physiquement la planète, c'est typiquement le genre de conclusions auxquelles on peut arriver quand on va au bout d'une réflexion de construction de monde en science-fiction, parce qu'on va s'obliger à comprendre quel monde permet telle ou telle chose. Par exemple, lors d’un atelier, quand quelqu'un me dit vouloir des voitures volantes, je vais demander combien ça coûte, qui va les fabriquer, quelles sont les ressources utilisées, quel impact sur la planète, est-ce qu'on peut se le permettre ? Est-ce qu’en prenant en compte le réchauffement climatique, c'est jouable? Est-ce que tout le monde y a accès ? C'est vraiment sur une vision très globale et systémique. Cela fonctionne aussi pour la réflexion autour de la décroissance. Il y a des personnes dont la vie dépend de ces technologies. Comment arbitrer ? Il me semble qu'une des clés est de réfléchir de manière globale. Il y a plein d'arbitrages possibles et en fonction des groupes, on n’arrive pas du tout sur les mêmes imaginaires du futur. Mais il y a cette idée forte à laquelle on ne peut pas échapper : on ne peut pas tout avoir, les choses ont un coût et nos belles utopies se font souvent au détriment d'autres personnes. Sincèrement, je trouve que les techniques de world building de la science fiction est quelque chose qui peut aider à améliorer le monde.
BF : Les sujets de la cybercriminalité et d’internet projettent tout de suite dans de la prospective assez fascinante pour l’anticipation et la SF. Il y a un enjeu politique et démocratique qui est très fort, qui amène rapidement sur le sociopolitique et enfin l'anonymat, la toxicité, les manipulations ont beaucoup d'enjeux psychologiques. Donc le sujet, en tant qu'écrivain, c'est jackpot ! Dans la trilogie, l’enjeu était de raconter ce système politique et moral de la transparence en trois étapes pour construire sa naissance, sa vitesse de croisière et sa radicalisation. Je n'ai pas fait l'effondrement, cela arrivera peut-être plus tard. J’ai commencé par la vitesse de croisière de ce système avec La Transparence selon Irina, en 2058 pour qu'on comprenne bien les enjeux. Ensuite, avec Le Silence selon Manon, qui se termine en 2025, je trouvais intéressant d’explorer comment le monde en était arrivé là. Ce sont les prémices de la transparence et la fin de l’anonymat. Dans L’Absence selon Camille, les événements reprennent directement après la fin de La Transparence. C’est une sorte de confrontation entre les deux mondes, dans une logique de radicalisation de la transparence, un parti politique radical qui veut aller encore plus loin dans le contrôle et qui, malheureusement, ne rencontre pas beaucoup d’opposition. C'est vraiment l'histoire d'une révolution ratée. Le propos du troisième tome est assez important au vu de la situation actuelle.

Ketty, comment considérez-vous ce concept d’esprit critique ?
K.S : L’esprit critique a deux définitions différentes. La première chose est l'esprit critique en tant que faculté à s'interroger sur ce qu'on perçoit, ce qu'on pense, etc. Pour moi, c'est la base, le fait de revenir sur soi, de douter. La deuxième chose est l'esprit critique comme étant une communauté de gens qui proposent des outils et qui oublient eux-mêmes de douter. J'ai une grande méfiance envers la zététique [méthode philosophique aussi appelée didactique de l’esprit critique qui consiste à rechercher la solution d'un problème en le supposant résolu et en remontant de cette solution jusqu'aux termes initiaux en vérifiant le bien-fondé de chaque étape, ndlr] et l'esprit critique, parce que ces personnes vont remplacer des certitudes par d'autres certitudes, et ne s’interrogent pas sur elles-mêmes. Cet idéal de rationalité ne correspond pas à la réalité du modèle cognitif de l'humain. Ça suppose qu'il y aurait une façon parfaite de penser, sans biais, et que l'objectif serait de ne pas avoir ces biais pour penser juste. L'être qui pense juste n’existe pas, notre cerveau n'est pas fait pour ça. Ce doit être hyper rassurant de se dire qu’il existe une liste de tous les biais et qu’on peut en sortir grâce à des outils. Est-ce que ça nous protège des dérives qu'il peut y avoir dans le monde numérique? Je n’en suis pas certaine. La construction sociale de tout un tas de comportements, n’est pas prise en compte dans ces milieux, et c’est pourtant ce qu'il faut interroger. La question est de savoir comment faire pour lutter contre les biais.
Benjamin, comment ce sujet de la cybersécurité s’articule-t-il avec l’idée d’identité et d’anonymat ?
BF : L'anonymat est une des valeurs fondamentales des débuts d'Internet, qui à l’origine allait permettre à des voix qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans le monde réel de trouver une caisse de résonance tout en étant protégées. Ce pouvait être des activistes politiques, des lanceurs d'alerte… L’anonymat participe à cette idée de libération de l'information, et d’émancipation personnelle : étant anonyme, on va pouvoir vraiment dire tout ce qu'on pense, libérer des contingences de la société. J'ai été très fan du concept à l’arrivée d’Internet. Et puis avec le temps, il s'est passé plusieurs choses, au niveau personnel et au niveau global, qui ont changé mes perceptions. J'ai entretenu une relation d'amitié très forte avec quelqu'un qui, je ne m’en suis aperçu qu’au bout de cinq ans, n'existait pas. C’était un personnage complètement construit par quelqu'un d'autre, et l'anonymat avait rendu possible cet énorme mensonge et cette manipulation. Et puis en parallèle, on a commencé à voir apparaître la question des fake news, de manipulation de l'opinion et puis une toxicité généralisée en ligne où, sous couvert d'anonymat, les femmes et les minorités étaient confrontées au harcèlement, il y a eu des raids provenant de forces politiques organisées pour manipuler les gens. Et donc je me retrouvais un peu entre deux eaux : être à la fois un fan de la première heure de l'anonymat tout en me demandant s’il n’était pas en train de tuer la démocratie. De là m’est venue l'idée d’écrire une trilogie qui allait aborder cette question de la transparence à travers plein de personnages différents qui allaient chacun représenter des facettes du débat : est-ce qu'il faut être transparent et utiliser sa vraie identité ou non sur Internet ?
Quel est votre propre rapport aux réseaux sociaux et aux outils numériques au quotidien ?
KS : En général, les technologies m'intéressent à titre personnel, on pourrait dire que je suis un peu geek, même si je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais je sais parler aux machines et parfois elles me répondent. J'ai doucement reculé sur mon utilisation des réseaux. J'étais assez active sur Twitter, notamment avec un défi d'écriture. Depuis un an, X [anciennement Twitter, ndlr] est devenu beaucoup plus compliqué, mon compte existe encore et sert d'archives de ce défi numérique d’écriture, mais je ne l'utilise plus. N'étant pas une personne très visuelle, j'ai beaucoup de mal avec Instagram, c’est l’endroit où je vais faire des annonces sur mon actualité, mais ça me prend un temps fou et j’ai renoncé à apprivoiser l'algorithme qui change trop souvent. J'ai un compte sur Mastodon, sur lequel je continue de poster les micro-nouvelles qui étaient auparavant sur Twitter. Je tiens à faire de la littérature sur des espaces interstitiels, comme ceux-là. Depuis décembre, je les reposte sur Blue Sky, même si je ne suis pas convaincue par le réseau. Et j’ai une page Facebook qui traîne depuis 2008. Je suis revenue à la newsletter mensuelle depuis un an et demi avec mes actualités mais aussi des petits bouts de réflexions. Les personnes inscrites ont envie de me lire. Ça me semble plus direct et plus sain, et je ne joue pas avec un algorithme qui n'aime pas les femmes noires qui parlent. Depuis que je me suis retirée un peu des réseaux, j’ai récupéré pas mal de temps pour faire d'autres choses.
- Lire aussi : Le numérique pour les enfants : conseils aux parents
BF : Je pense que j'ai perdu en optimisme. Quand j'ai commencé ce projet de trilogie, j’avais la conviction qu'Internet était une place de débat public et démocratique et que même si on manquait de maturité sur le sujet, c'était quand même le meilleur endroit pour débattre et faire avancer la société. Aujourd'hui, avec ce qui se passe politiquement, les manipulations à n'en plus finir, tout le monde se fait au moins avoir une fois par mois par une fake news, même en étant hyper vigilant. Et l'intelligence artificielle qui se développe ajoute un masque de complexité à tout ça. J'ai l'impression que mes idéaux, auxquels je crois encore théoriquement, prennent quand même un coup dans l'aile, car on est rattrapé par la réalité et par la violence de ce monde. Mais mon discours n'a pas changé. Les réseaux sociaux et Internet sont des outils. Soit tu peux croire que collectivement on va réussir à en faire un truc super qui va réussir à nous tirer vers le haut, soit tu es défaitiste et dire qu'on va tout gâcher, à l'image de Twitter par exemple. On préférerait qu’Internet devienne à l'image de Wikipédia avec de l'open source, des informations vérifiées, des règles claires, des bons contenus. C’est un peu caricatural de dire ça, mais on est un peu à un embranchement entre les deux, devenir X ou Wikipédia ? Et je pense qu'il faudrait qu'on pousse pour que l’avenir devienne plutôt Wikipédia.
Ketty Steward est écrivaine de romans, de poésie, d’une pièce radiophonique, d’un essai, et de nouvelles en recueil comme Saletés d’hormones et autres complications.
Benjamin Fogel est éditeur d’essais sur la pop culture et auteur de romans, comme la trilogie de la transparence et son dernier opus, L’Absence selon Camille.