Connaissez-vous le sharenting ? Issue de la contraction des mots anglais share et parenting, cette pratique désigne la publication par des parents de photos ou de vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Apparu pour la première fois en 2012 sous la plume du journaliste américain Steven Leckart, le phénomène est loin d’être une mode. L’étude « Parents influenceurs », publiée en 2023 et commandée par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN), révèle ainsi que 53 % des parents français, particulièrement les jeunes parents, ont déjà partagé du contenu sur leur(s) enfant(s) sur les réseaux sociaux, dont 43 % ont commencé dès la naissance de ce(s) dernier(s).
« Le sharenting est en nette hausse depuis la pandémie de Covid-19, en 2020, lorsque le besoin de rester en lien avec ses proches a poussé tout le monde, adultes comme enfants, à être très connectés », observe Socheata Sim, responsable de la mission sociale France de Caméléon, une association luttant contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et la militante d’alerter : « Lorsqu’on publie les photos d’un enfant, il faut avoir en tête qu’elles pourront le suivre toute sa vie et tomber entre les mains de camarades harceleurs au collège ou de pédocriminels. »
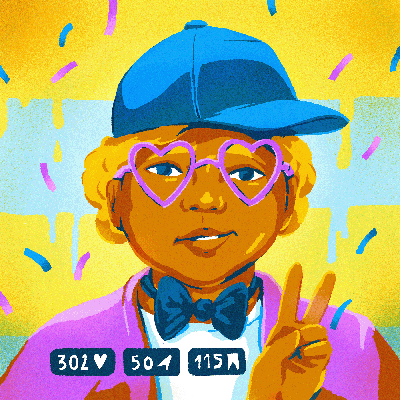
Un risque d’exposition aux cyberagressions
L’année dernière, Caméléon a mené une campagne de sensibilisation alertant sur les dangers liés au sharenting, en particulier sur le risque que les images tombent entre les mains de cyberprédateurs. D’après une ONG américaine, 50 % des photos publiées sur les forums pédopornographiques proviennent en effet de clichés pris par les parents puis partagés sur les réseaux sociaux. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Grâce aux données glanées, les quelque 750 000 prédateurs sexuels qui sévissent en ligne disposent d’informations qu’ils peuvent ensuite utiliser pour entrer en contact physiquement avec leurs victimes ou pour se lier d’amitié avec leurs parents.
Quelques gestes simples permettent de limiter les risques de cyberagressions: faire attention aux arrières plans des photos trop facilement identifiables, éviter les tags ou de divulguer des informations personnelles concernant son enfant. Les associations de protection de l’enfance incitent également à en parler à son entourage. « Les parents ont beau être sensibilisés et veiller à ne pas partager publiquement des photos ou des informations permettant d’identifier leurs enfants, ce n’est peut-être pas le cas de leurs proches, rappelle Socheata Sim. Et dans ce cas, les photos ou vidéos peuvent vite sortir du cercle de confiance familial. »
Le consentement de l’enfant en question
Le sharenting pose aussi la question du consentement de l’enfant. La psychologue Aline Nativel Id Hammou rappelle que « la notion de consentement intervient autour de six ans, lorsqu’un enfant est capable de verbaliser un refus à ses parents s’il n’a pas envie d’être pris en photo », puis « autour de ses dix ans », lorsqu’il acquiert la compréhension de ce qu’implique le fait d’avoir sa photo publiée sur un réseau social. Ainsi, même si les parents éprouvent le besoin de partager du contenu « par fierté pour leur progéniture », la non prise en compte du consentement de cette dernière peut provoquer un « impact psychologique ».
Dans son cabinet de consultation, certains enfants lui déclarent ainsi subir une forme de pression, comme ce garçon de huit ans qui décrit devoir « prendre vingt fois la pose pour que papa et maman puissent faire la photo parfaite ». « Si cette non prise en compte du consentement devient récurrent, l’enfant peut avoir le ressenti de ne pas être considéré comme un être humain doté de volonté, d’être une sorte de poupée pour ses parents, poursuit la psychologue. À terme, cela peut ébranler la confiance de l’enfant en son parent. » Outre l’aspect psychologique, Socheata Sim estime que la publication de la photo d’un enfant sans son consentement « pose la question éthique de responsabilité des parents et du droit à l’image et à la vie privée des enfants ».
Arthur Melon, délégué général du Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE), attire également l’attention sur l’absence de référence au consentement des enfants quant à la gestion de leur image dans le droit français: « Le droit actuel prévoit que le droit à l’image de l’enfant est géré par ses parents, mais on constate qu’ils n’utilisent pas toujours ce pouvoir à bon escient et considèrent qu’ils n’ont pas à demander l’avis de leur enfant avant de publier une photo de lui. »
Un cadre juridique en évolution
Depuis janvier 2023, une proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants est en discussion [texte toujours en discussion à la parution de cet article]. Déposée par le député Bruno Studer, à l’origine d’une autre loi encadrant le travail des enfants influenceurs, elle prévoit notamment que les parents doivent veiller au respect de la vie privée de leur enfant ou qu’un tiers puisse saisir la justice si la diffusion de l’image d’un enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
Le COFRADE, tout en saluant les avancées permises par ce texte, trouve néanmoins qu’il ne va pas assez loin. « La proposition d’aggravation de la sanction pénale en cas d’atteinte à la réputation de l’enfant n’a pas été retenue», regrette Arthur Melon. « La publication de certains contenus s'apparente à des violences éducatives, ce qui justifierait selon nous qu’une autorité, comme un juge aux affaires familiales ou la Cnil, soit saisie pour les retirer des plateformes », complète Socheata Sim.









